 Université du temps libre de Haute Mayenne
Université du temps libre de Haute Mayenne

LES COURS
- Littérature 2025-2026
- Oenologie 25-26
- Sciences : 25-26
- Histoire de l'art - expositions 25-26
- histoire de la Mayenne 25-26
- Informatique 25-26
- Atelier d'écriture 25-26
- Histoire de la musique 25-26
- Philosophie 25-26
- Histoire de la Russie 25-26
- La prostituée à Paris au 19è 25-26
- Le cinéma 25-26
- Histoire et Archéologie 25-26
- Histoire des civilisations 25-26
- Economie 25-26
- MUSEE DU CHATEAU DE MAYENNE 25-26
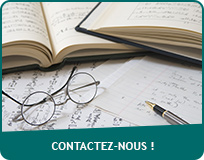
HISTOIRE DE LA MAYENNE 25-26
Histoire du fait religieux en Mayenne
La Mayenne terre de foi et de piété populaire a aussi été une terre de tensions religieuses. Les diverses formes de dévotions et des conflits idéologiques en marquent les mentalités jusqu'à nos jours.
Dans l'auditorium du Grand Nord, le jeudi de 14 h à 16 h
Pour un groupe de 100 personnes Sous réserve d'un nombre suffisant de participants
|
30/04 |
7/05 |
21/05 |
28/05 |
- 1. Le chemin montais : du Mans au Mont Saint-Michel, parcours en Mayenne
Par Jacques NAVEAU, historien, archéologue
Attesté depuis le 9e siècle, le pèlerinage au Mont Saint-Michel a été un moment essentiel dans la vie de milliers de personnes. Sous l'impulsion d'associations œuvrant à réhabiliter les chemins d'accès au Mont, il tend même à redevenir d'actualité. Oublions l'idée romantique de routes créées dans le but de conduire les foules médiévales au sanctuaire de l'archange. La réalité est infiniment plus complexe. Si le phénomène a eu un caractère massif entre le 16e et le 18e siècle, on est très mal informé sur les périodes antérieures. Les textes et les premières cartes routières permettent d'identifier une voie désignée comme « grand chemin montais » à partir du 16e siècle, venant du Mans et traversant le nord de la Mayenne. Nous le suivrons de Saint-Pierre-sur-Orthe à Landivy,
- 2. Les croix rurales de la Mayenne, une expression de l'histoire des mentalités.
Par Alain GUEGUEN, auteur de Croix et Calvaires de la Mayenne, membre de la SAHM.
Le département de la Mayenne conserve plus de 5000 croix. Un record dans l'ouest de la France ! Dans une société rurale, elles témoignent d'une christianisation de l'espace. Quelle est la signification religieuse et sociale de ces petits monuments ? Au cours de grandes périodes, dans quel cadre sont-elles édifiées et pour quelles fonctions ? Qu'est-ce qui autorise leur élévation ? Quel message diffuse-t-elle ? Quel rapport ont-elles avec l'organisation structurée paroissiale et des croyances populaires collectives et privées ? Elève-t-on encore des croix aujourd'hui ?
- 3. Les curés mayennais pendant le Révolution : la déchirure
Par Gaston CHEREL, historien.
Au début de la Révolution, la nationalisation des biens du clergé, conduit à une réorganisation complète du catholicisme français ; c'est la fonction de la Constitution civile du clergé, un texte fondamental établi sans concertation avec le pape, ce qui trouble beaucoup de prêtres. Comment concilier sentiment civique et engagement sacerdotal ? L'obligation du serment oblige les curés à choisir leur camp. Ils se divisent et c'est Napoléon Bonaparte qui, par le concordat de 1801, restaure l'unité du catholicisme.
- 4. Le diocèse de Laval : de sa création (1855) à la Séparation (1905)
Par Gaston CHEREL, historien.
La création d'un évêché à Laval répond aux attentes des catholiques mayennais. Le premier évêque de Laval, Mgr Wicart, organise le nouveau diocèse dans le cadre du régime concordataire en place depuis 1801. Jusqu'à la Séparation de 1905, la vitalité des paroisses est indéniable, les fabriques sont dynamiques et on construit beaucoup d'églises. Le catholicisme mayennais, souvent encadré par des grands propriétaires terriens, paraît triomphant mais doit composer avec le progrès des idées républicaines et l'influence de nouveaux notables.

