 Université du temps libre de Haute Mayenne
Université du temps libre de Haute Mayenne

LES COURS
- Littérature 2025-2026
- Oenologie 25-26
- Sciences : 25-26
- Histoire de l'art - expositions 25-26
- histoire de la Mayenne 25-26
- Informatique 25-26
- Atelier d'écriture 25-26
- Histoire de la musique 25-26
- Philosophie 25-26
- Histoire de la Russie 25-26
- La prostituée à Paris au 19è 25-26
- Le cinéma 25-26
- Histoire et Archéologie 25-26
- Histoire des civilisations 25-26
- Economie 25-26
- MUSEE DU CHATEAU DE MAYENNE 25-26
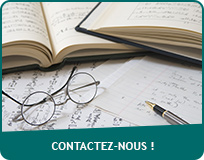
HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 25-26
LA RENAISSANCE EN FRANCE ET DANS LES PAYS GERMANIQUES
Cycle de 4 séances de 2 heures assuré par Jacques NAVEAU, historien et archéologue.
Le mardi de 14 h à 16 h dans l'auditorium du Grand Nord.
Pour un groupe de 100 personnes Sous réserve d'un nombre suffisant de participants
|
6/1 |
13/1 |
20/1 |
3/2 |
- 1. Les prémices de la Renaissance en France, 1480-1520
L'entrée de la France dans ce grand mouvement européen des arts et des idées que l'on appelle la Renaissance ne se résume pas à l'emprunt de formes et de concepts venus d'Italie. La question est complexe car la France est voisine d'un autre pôle culturel puissant au 15e siècle, le pôle flamand. Là se déroule ce que l'on a parfois appelé une Renaissance nordique, dont la source n'est pas dans la redécouverte de l'Antiquité mais dans l'évolution du gothique.
C'est d'un dialogue entre ces deux influences que naîtra une Renaissance française.
- 2. L'âge mûr de la Renaissance française
Après 1520, il est légitime de parler d'une « Renaissance à la française ». Elle s'est constituée par un jeu d'échanges paradoxal où l'attrait évident pour l'Italie s'accompagne d'une volonté de s'affirmer face à elle, ce qui contribue à nourrir la naissance précoce d'un sentiment national. Celui-ci est fortement encouragé par la monarchie, François Ier en tête dont l'action en faveur de la langue nationale est indissociable de celle en faveur des arts. Mais cette politique ne s'accompagne pas de repli, comme le montre l'accueil de nombreux artistes italiens ou flamands et le rôle que les premiers ont joué dans la création d'une « école de Fontainebleau »..
- 3. Imprimerie et Renaissance
« L'invention de l'imprimerie, écrit Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, est le plus grand événement de l'histoire. C'est la révolution mère ». De là à penser qu'une telle invention a pu générer le mouvement culturel, tout aussi enthousiasmant, que l'on résume dans le mot Renaissance, il n'y a qu'un pas. Ajoutons à cela la tradition d'un génie solitaire, Gutenberg, découvrant dans une illumination la nouvelle technique, et l'on tient tous les éléments d'un récit simplificateur et agréablement romantique.
Mais l'histoire n'aime pas les simplifications. Il n'en demeure pas moins que l'imprimerie colle à l'esprit du temps et a fourni une aide essentielle, et sans précédents, à la diffusion de la pensée.
- 4. De Vienne à Colmar : promenade artistique en pays germanique vers 1500
De Vienne à Colmar, le parcours proposé ici traverse ce qui fut le Saint Empire romain germanique dans sa partie méridionale et correspond, en grande partie, au cours supérieur du Danube. Bien des villes bordant le fleuve, comme Krems et Stein en Autriche ou Regensburg (Ratisbonne) en Allemagne, ont conservé un riche patrimoine de maisons et de bâtiments publics qui donne à leur centre historique un aspect de la fin du Moyen Âge.
L'architecture gothique ne s'est imposée sur les terres de l'Empire que dans la deuxième moitié du 13e siècle. Elle s'est rapidement détachée des influences françaises, trouvant sur place des traditions et des architectes qui ont donné naissance à un gothique allemand.

